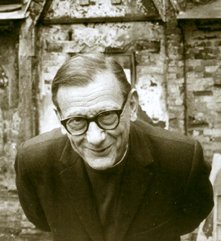 |
| Jean Daniélou 1905-1974 |
Les témoignages académiques sur
l’œuvre de Jean Daniélou ne manquent pas. En témoigne le magnifique volume intitulé
Epektasis, mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou [1],
paru après qu’il fut élevé à la pourpre cardinalice, où plus de 40
universitaires lui rendaient hommage. Ou encore, au lendemain de sa mort, les
vibrants témoignages d’Henri-Irénée Marrou [2],
de Maurice de Gandillac ou d’Olivier Clément, recueillis dans un numéro spécial
de la revue Axes [3].
On connaît également les
dialogues œcuméniques qu’il entretint avec quelques-uns des grands
intellectuels de son temps, à l’image de sa conversation sur le judaïsme
entamée avec André Chouraqui et qui fut immortalisée sous la forme d’un livre paru aux éditions Beauchesne [4].
Jean Daniélou était également un habitué des réunions intellectuelles
informelles qui se tenaient le dimanche après-midi à Clamart, dans la maison du
philosophe orthodoxe Nicolas Berdiaev [5].
C’est encore lui qui, en 1944, après la fameuse conférence de Georges Bataille
sur le péché, introduisit le débat, non moins fameux, qui s’ensuivit et
auxquels participèrent ou assistèrent Marcel Moré, Maurice Blanchot, Simone de
Beauvoir, Albert Camus, Jean Hyppolite, Pierre Klossowski, Michel Leiris,
Jacques Madaule, Gabriel Marcel, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean
Paulhan et, évidemment, Jean-Paul Sartre [6].
Sont moins connues ses relations
avec les artistes. Qui se souvient, par exemple, que c’est à Jean Daniélou que
Jean Cocteau fit appel afin de traduire
en latin le livret de l’opéra Œdipus Rex que
ce dernier avait écrit à la demande d’Igor Stravinsky dans les années 1920 ? [7]
Qui sait encore la très forte
impression qu’il fit sur le pourtant fort peu impressionnable Paul
Morand ? Nous sommes en 1972, Jean Daniélou, candidat à l’Académie
française, s’apprête selon l’usage à rendre visite aux académiciens. Le 17 juin
de cette année, Paul Morand note dans son journal : « Je compte
dire au cardinal Daniélou : Je voterai pour vous […] Ceci dit, je vomis la
Rome moderne et les prêtres qui disent la messe en tournant le dos à l’autel.
Ne me raisonnez pas, c’est physique. Les dernières prières que j’entendrai
bientôt prononcer à mon chevet seront celles d’un prêtre orthodoxe. » [8]
Mais, deux ans plus tard, le même Morand de noter dans ce même journal au
lendemain du décès de Daniélou : « E. m’annonce la mort du
cardinal Daniélou, l’homme du monde le plus vif, le plus gai, le plus charmant,
qui siégeait souvent à mes côtés, à l’Académie. C’est un grand chagrin ;
je pensais souvent qu’il me fermerait les yeux. » [9]
Paul Morand mourra le 23 juillet
1976 et, le cardinal Daniélou disparu, ce fut bien un prêtre orthodoxe qui
prononça à son chevet les dernières prières qu’il entendit. Ses obsèques
seront célébrées par le métropolite Mélétios, exarque du patriarche de
Constantinople à la cathédrale orthodoxe Saint-Etienne, sise rue Georges-Bizet,
à Paris. Ses cendres rejoindront enfin celles de son épouse Hélène, au
cimetière orthodoxe de Trieste…
[1]Ouvrage
collectif paru aux éditions Beauchesne en 1972.
[2]
Rappelons que Jean Daniélou se partagea avec Henri-Irénée Marrou le travail
nécessaire à la mise au point du premier volume de la Nouvelle Histoire de l’Eglise, De
la persécution de Dioclétien à la mort de Grégoire le Grand (303-604),
Paris, éd. du Seuil.
[3]
Jean Daniélou : 1905-1974, ouvrage
collectif publié par la Société des amis du cardinal Daniélou, Paris, éd. Axes/
Cerf, 1975.
[5]
Cf. Marie-Madeleine Davy, Nicolas
Berdiaev ou la Révolution de l'Esprit, éd. Albin Michel, coll. Espaces
libres, 1999.
[6]
Georges Bataille, Discussion sur le péché,
éd. Lignes, 2010. Ce livre réunit pour la première fois le texte intégral de la
conférence prononcée le 5 mars 1944 par Georges Bataille, l’introduction aux
débats de Daniélou et enfin, la célèbre « discussion » qui a suivi. Sur ce même
événement, on pourra aussi se référer avec profit au livre d’Etienne Fouilloux, Christianisme et eschatologie, Dieu Vivant, 1945-1955, éd. CLD, 2015.
[7]
Pour en savoir plus dur cet opéra qui fut créé le 30 mai 1927 au Théâtre Sarah
Bernhardt sous la forme d’un oratorio, cf.
Max Jacob, Jean Cocteau, Correspondance
1917-1944, éd. Paris-Méditerranée/Ecrits des Hautes-Terres, 2000, p. 252 et
254, note 2. Pour plus de détails encore sur cette œuvre collégiale, on pourra
se reporter à : Jean Cocteau, Journal
d’un inconnu, éd. Grasset, 1953, pp. 219-224 et Denise Tual, Le temps dévoré, éd. Fayard, 1980, pp.
253-268.
[8]
Paul Morand, Journal inutile, 1968-1972, vol. 1, éd. Gallimard, coll. Les cahiers de la NRF, 2001, p. 729. Le 3 novembre
1972, Morand reçoit effectivement la visite de Daniélou. La description qu’il
en donne est, tout à la fois, un bel exemple du style de Morand et de celui de
Jean Daniélou ! « Visite du cardinal Daniélou. Je le reçois au
salon, mais par politesse envers un prince de l’Eglise, je fais une partie du
chemin vers lui. Son admirable entrée : au lieu de suivre Raymond qui,
après lui avoir ouvert la porte, le conduit vers moi, Daniélou lui jette son
pardessus, le précède, traverse le hall en volant et s’élance les bras ouverts.
Décomposons : Daniélou : " Je
ne tolérerai pas que vous fassiez tant de pas vers moi, je tiens à abréger
cette politesse qui, chez un homme d’âge et de renom, me gêne" ;
il me tombe dans les bras, les deux mains tendues ; cet élan se traduit
par : " Vous avez eu la bonté de dire à mon beau-frère Isard que vous
voteriez pour moi ; grâces vous soient rendues, je suis éperdu de
reconnaissance. " Tout ceci, très au point, très bien joué, par un homme
fin, éveillé, rapide, rompu aux usages. »

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire